La gestion du risque est autant une affaire de perception sociétale que d’explication technique
Face au risque avéré ou supposé, l’affirmation péremptoire du politique ou le savoir technique arrogant de l’ingénieur ne suffisent aujourd’hui plus à gérer sereinement l’acceptation des progrès et des nouveautés technologiques. Qu’on le veuille ou non, la société civile nourrit désormais une perception du risque beaucoup plus complexe et subtile où le religieux, le philosophique, le mythe, l’éducation, l’éthique, le culturel (et bien d’autres critères encore) peuvent avoir autant d’impact et de poids, sinon plus que les critères économiques et technologiques.
Exit donc les justifications à grand renfort de statistiques et de probabilités, dehors les certitudes scientifiques et les schémas techniques. Même si le corps social les réclame impérativement par souci de sécurité et d’objectivation, il s’empresse paradoxalement de les contester aussitôt par peur de l’insécurité et surtout par méfiance envers des enjeux qui pourraient être cachés. Surtout lorsque des catastrophes humaines interviennent à intervalles réguliers, l’accident nucléaire de Fukushima au Japon venant à nouveau nous le rappeler.

La rationalité scientifique devient de moins en moins suffisante pour faire accepter le risque sociétal
Le sociologue allemand Ulrich Beck ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit dans son livre fondateur (1) : « La science devient de plus en plus nécessaire mais de moins en moins suffisante à l’élaboration d’une définition socialement établie de la vérité ». N’en déplaise par conséquent à ceux qui prétendent savoir, décider et contrôler pour le bien-être des autres, la perception du risque a muté avec la litanie des catastrophes industrielles et techniques qui ont émaillé le 20ème siècle et qui se poursuivent avec le siècle actuel.
Une perception qui se nourrit d’un paradoxe relevé par les chercheurs Christian Lefaure et Jean-Paul Moatti dans leurs divers ouvrages (2) : « Le sentiment d’insécurité s’alimente des progrès même des dispositifs de sécurité ; plus il y a de sécurité et plus il y a création concomitante d’insécurité ». L’attitude rationnelle, technique et scientifique ne suffit plus pour convaincre que les risques sont réellement maîtrisés et potentiellement acceptables.
Trois facteurs clés
L’aversion au risque s’est décuplée au sein de la société sous la conjonction de trois facteurs clés. La technologie a atteint aujourd’hui de tels niveaux de sophistication, de complexité et de vitesse d’évolution qu’il est de plus en plus difficile de saisir le véritable fonctionnement des choses pour le quidam peu ou pas averti et/ou de le lui faire comprendre et admettre. Un laboratoire de génie génétique qui cultive des cellules souches suscitera toujours plus facilement un sentiment d’opacité et de non-familiarité aux yeux du grand public qu’une classique usine fabriquant des voitures ou des ustensiles ménagers.
S’ajoute ensuite le sentiment de non-contrôlabilité des activités parce que la science n’apporte pas toujours illico toutes les réponses aux interrogations qui naissent avec l’innovation. C’est le cas symptomatique des cultures transgéniques. Sous l’impulsion de puissantes entreprises multinationales, les semences issues du génie génétique gagnent du terrain dans les champs et dans les assiettes. Cà ou là, les législateurs oscillent entre pragmatisme permissif et principe de précaution restrictif tandis qu’à l’opposé, des groupes activistes et des hérauts emblématiques diabolisent le risque sanitaire absolu des OGM (organismes génétiquement modifiés), fauchent des récoltes entières pour freiner leur déploiement et attirer l’attention des foules. Tout ceci dans un contexte où à ce jour, rien n’est clairement établi en faveur ou en défaveur de l’utilité de ces produits. Souvent parce que le temps de la science n’est pas celui de l’avancée technologique !
Enfin, c’est le potentiel catastrophique des activités qui vient corser cette allergie anxiogène envers le risque. Ce dernier n’est plus cantonné à une aire géographique ou à un périmètre identifié. Le nuage de Tchernobyl ou celui de Fukuschima sont à cet égard suffisamment symboliques de cette peur transfrontalière. A cause de l’explosion du cœur d’une lointaine centrale nucléaire délabrée en Ukraine ou d’une usine submergée par un tsumani, les pays avoisinants ont vu leur taux de radioactivité s’orienter soudainement à la hausse.
L’impossible exigence de sécurité absolue de la société

Le corps social ordonne un impératif d’infaillibilité plutôt que leur simple rationalité scientifico-économico-technique (dessin de Plantu dans Le Monde)
Une chose est certaine. Où qu’il soit, nul ne peut connaître avec précision le degré de risque auquel il est exposé et nul ne dispose de la possibilité de s’en protéger entièrement. Dès lors, l’exigence de sécurité devient supérieure à la sécurité possible. Aux experts et aux décideurs, le corps social ordonne un impératif d’infaillibilité plutôt que leur simple rationalité scientifico-économico-technique.
Aujourd’hui, la perception du risque se joue sur le terrain sociologique. Le sociologue et statisticien, Patrick Peretti-Watel (3), en est convaincu : « Les opinions et les attitudes à l’égard du risque dépendent aussi des valeurs auxquelles nous croyons, de la culture à laquelle nous adhérons. Ce « biais culturel » rend souvent inopérants les arguments scientifiques, car il situe le débat à un autre niveau ».
La représentation du risque diffère en effet selon des variables sociales et culturelles intrinsèquement liées au contexte et aux acteurs évoluant en son sein. Un paysan des zones montagneuses du Népal n’aura pas la même vision du réchauffement climatique qui se traduit à ses yeux par une fonte accélérée des glaciers et des inondations plus fréquentes tandis qu’un pêcheur des Maldives y voit avant tout la mort lente du corail et la raréfaction des bancs de poissons. Dans les deux cas, le risque est pourtant identique aux yeux d’un climatologue. Simplement, le paysan népalais et le pêcheur maldivien vont être des percepteurs à la vulnérabilité différente.
Or souvent, ces dimensions sont laissées pour compte au motif qu’elles ne sont pas scientifiques ou rigoureusement techniques, qu’elles émanent de l’émotionnel, du profane et de la croyance donc du subjectif et du superfétatoire ! Quand il s’agit d’évaluer un risque, toutes les sensibilités ont pourtant leur importance, y compris celles qui peuvent apparaître irréductiblement non-recevables par des esprits cartésiens et mécanistes au savoir inébranlable !
Quatre types culturels
Dans ses travaux de recherche (4), l’anthropologue britannique Mary Douglas a défini quatre catégories culturelles qui conditionnent la manière dont un risque peut être perçu ainsi que la connotation négative ou positive qui va lui être associé en fonction du contexte. Selon elle, cette typologie s’applique indifféremment à une société dans son ensemble comme à un groupe d’acteurs autour d’un sujet spécifique. En fonction de sa culture d’appartenance, un individu n’aura donc pas les mêmes réactions à propos du risque qui le concerne.
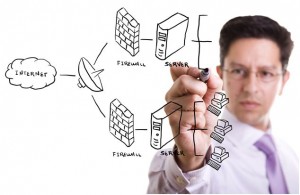
De mentalité bureaucratique, la 1ère catégorie identifiée par Mary Douglas a tendance à être assez aisément aveugle ou péremptoire à l’encontre du risque
Baptisée « structure hiérarchique », la première catégorie est essentiellement caractérisée par le respect du savoir scientifique produit par les savants et de l’autorité détenue par les décideurs. Selon Patrick Peretti-Watel (5), cette catégorie « est par essence routinière, rigide. Elle ne sait pas s’adapter aux transformations de son environnement, elle détecte mal l’émergence de nouveaux problèmes et ne sait y répondre qu’en instituant de nouvelles réglementations ». De mentalité bureaucratique, cette catégorie a donc tendance à être assez aisément aveugle ou péremptoire à l’encontre du risque. De plus, elle admet mal le franc-tireur qui remet en cause l’ordre établi. Enfin, elle tarde souvent à réagir lorsque le risque se confirme véritablement.
A l’opposé de cette première catégorie, se situe un second groupe que Mary Douglas qualifie d’ « individualiste ». Si ce groupe se fie volontiers au savoir officiel comme le « hiérarchique », il est en revanche beaucoup plus ouvert à l’égard de l’incertitude qu’il considère comme une opportunité de progresser mais seulement avec une vision court-termiste et un besoin de rentabilité immédiate. De mentalité entrepreneuse, cette catégorie n’hésite donc pas à prendre des initiatives sous couvert de ce savoir officiel, toujours dans une perspective temporelle limitée et sans forcément se soucier des conséquences liées à ses initiatives. En revanche, elle redoute les risques qui peuvent entraver ou bloquer le bon fonctionnement du marché ou engendrer un excès de réglementations. Ce qui constitue à ses yeux, des obstacles à l’initiative.

La 3ème catégorie fait preuve d’une extrême méfiance envers les autorités qui détiennent le pouvoir et le savoir
La troisième catégorie appelée « sectarisme égalitaire » par Mary Douglas, rassemble des petits groupes assez repliés sur eux-mêmes et plutôt à l’écart de la société. Ces petits groupes ont tendance à instaurer des règles égalitaires entre eux et font preuve d’une extrême méfiance envers les autorités qui détiennent le pouvoir et le savoir. Pour eux (6), « l’autorité scientifique ou politique d’un individu est de source charismatique. Elle repose sur son talent personnel, plus que sur sa position hiérarchique ou ses diplômes ». De mentalité sectaire (le mot étant pris ici dans l’acception de partisan exalté), leur appréhension à l’égard des risques est importante, plus particulièrement ceux qui sont irréversibles ou qui mettent en péril la survie de l’espèce humaine sur le long terme. Cette catégorie n’hésite pas à dénoncer le système social et à s’opposer aux catégories « hiérarchiques » et « individualistes », qu’elle accuse d’emmener le monde à sa perte. Une opposition collective qui renforce par nature sa propre cohésion interne et la conviction que son combat est juste.
La dernière catégorie de la typologie culturelle de Mary Douglas est qualifiée d’« isolée ou d’exclue ». Elle rassemble en fait des individus peu organisés entre eux, peu ou mal informés et plutôt soumis ou aisément suiveurs de la société. Dans ce groupe, les opinions ne sont pas clairement tranchées et plutôt aléatoires. Elles peuvent être en même temps versatiles, temporaires ou fantaisistes lorsqu’elles s’expriment. Autre caractéristique récurrente de ce groupe : le fait de nourrir de temps à autre des soupçons envers les autorités et de contester le savoir et le pouvoir. Toutefois, il peut à l’inverse, totalement abonder dans le sens de ces mêmes autorités et se référer à leur savoir et leur pouvoir si une situation lui convient ou si elle ne l’affecte pas particulièrement. Face au risque, il adopte la même ambivalence oscillant souvent entre résignation passive car il n’a pas le choix et prise de risque fataliste car il est persuadé qu’il n’existe pas d’autre solution viable.
Les réseaux sociaux numériques changent la donne

Gestion du risque et valeurs culturelles sont indissociables surtout à l’heure des réseaux sociaux numériques
La matrice anthropologique de Mary Douglas apporte un éclairage fort utile pour comprendre comment les préférences culturelles peuvent introduire des variables considérables influençant en profondeur l’acceptabilité du risque selon telle ou telle catégorie d’individus. Ceci devient d’autant plus crucial à comprendre aujourd’hui qu’avec l’avènement des réseaux sociaux, ces 4 catégories peuvent très vite sur n’importe quel sujet, entrer en conflit, en résonnance et au final générer contestation, adversité, blocage que cela soit justifié ou pas. Le récent scandale DSK montre combien chaque typologie de groupe s’arroge la parole selon sa vision du monde et ses convictions et que tout et son contraire sont allègrement mélangés dans une affaire qui relève avant tout du droit commun (même si la chute d’un tel personnage influent ne pouvait évidemmment pas laisser de marbre!).
Le contexte où évoluent ces individus est également un facteur déterminant. Pour les chercheurs américains Jeanne et Roger Kasperson qui travaillent sur la notion de risque global depuis plusieurs années et sur la façon dont il est identifié, conceptualisé et traité à l’échelle internationale, le risque est le produit conjoint des perturbations environnementales et de la fragilité des percepteurs. En d’autres termes, la sensibilité à un risque donné ne se réduit pas seulement à sa dangerosité potentielle fondée sur des critères techniques et scientifiques. Elle va aussi fortement dépendre du contexte référentiel propre à chacun des acteurs du moment, des valeurs auxquelles ils souscrivent à titre personnel et des mythes auxquels ils croient.
Ce sont ces éléments socio-culturels qui vont ensuite structurer la représentation d’un risque aux yeux des uns et des autres. Ce sont ces éléments qui vont influer sur les degrés d’acceptabilité ou au contraire de non-acceptabilité d’un risque. Pour les deux auteurs (7), l’analyse du risque doit obligatoirement intégrer la totalité « des espoirs et des peurs des populations en des termes qu’elles peuvent saisir » et leur permettre de « répondre et d’apporter leurs contributions ». Cet appel à l’interdisciplinarité revendique clairement la nécessité absolue d’intégrer le biais socioculturel dans la gouvernance des risques.
Conclusion
Risques et valeurs culturelles sont donc indissociables. Cet enchâssement s’exerce à deux niveaux pour Patrick Peretti-Watel (8) : « D’abord, nos valeurs cadrent nos expériences, elles influencent notre perception des risques. Selon sa culture, chacun privilégie telle ou telle source d’information, se représente son corps et la nature d’une telle façon. Ensuite, ces valeurs donnent du sens aux risques, en déterminent la polarité, en distinguant les risques qui sont à craindre, ceux que l’on peut oublier et ceux qu’il faut prendre ».
A laisser se creuser le fossé entre les perceptions des uns et des autres, la crise couve. C’est d’autant plus crucial qu’à ce jeu de miroirs entre perceptions des uns et des autres, vient s’ajouter un enjeu d’image qui brouille un peu plus la donne dans la gouvernance des risques. L’image (dont se nourrissent aussi les perceptions) est également sujette à de profondes distorsions entre le réel, le souhaité, le projeté et le perçu. Ces distorsions sont également souvent négligées et recèlent à leur tout de nouveaux ferments de crise ! A l’ère des réseaux sociaux où la moindre étincelle est d’emblée connue de l’ensemble de la planète, il serait temps que la gestion des risques cesse d’être uniquement un argumentaire juridico-technique teintée de communication cosmétique pour s’auto-rassurer. Qu’on le veuille ou non et qu’elle ait raison ou pas, la dimension sociétale doit être intégrée. Sinon les risques de fracture irréconciliables seront encore plus grands et pas forcément au bénéfice de ceux qui croyaient tout maîtriser avec leur savoir encyclopédique d’ingénieur infaillible !
Sources
1 – Ulrich Beck – La société du risque : sur la voie d’une autre modernité – Aubier – 2001
2 – Christian Lefaure et Jean-Paul Moatti – « Les Ambiguïtés de l’acceptable » – Culture technique n°11 – PUF – Septembre 1983 & « Perception du risque, demande de sécurité, acceptabilité sociale des techniques – Germes n°10 – 1985
3 – Patrick Peretti-Watel – La société du risque – 2001 – La Découverte
4 – Mary Douglas – Risk and Blame, Essays in cultural theory – Routledge – London
5 – Patrick Peretti-Watel – La société du risque – 2001 – La Découverte
6 – Patrick Peretti-Watel – La société du risque – 2001 – La Découverte
7 – Jeanne et Roger Kasperson – Global Environmental Risk – United Nations University Press – Earthscan – 2001
8 – Patrick Peretti-Watel – La société du risque – 2001 – La Découverte

















